« Cette fois-ci, c’est différent. »
La formule revient à chaque révolution technologique, comme une justification universelle des excès financiers. Et pourtant, l’histoire ne cesse de rappeler qu’aucune innovation, aussi radicale soit-elle, n’échappe totalement aux cycles de l’exubérance et de la correction.
I. Les signaux faibles d'un excès
Le 3 octobre dernier, à l’Italian Tech Week de Turin, deux voix parmi les plus écoutées de la finance et de la technologie ont jeté un froid sur l’euphorie ambiante.
• David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a mis en garde : « Beaucoup de capitaux investis dans l’IA ne délivreront pas de rendement. » Pour celui qui incarne le cœur battant du financement mondial de l’innovation, ce constat tranche avec le consensus des marchés.
• À ses côtés, Jeff Bezos a enfoncé le clou en évoquant une « bulle industrielle » autour de l’intelligence artificielle. Une bulle, donc, inévitablement appelée à se dégonfler. Mais Bezos y voit une bulle « productive », laissant derrière elle infrastructures, savoir-faire et nouvelles opportunités.
Ce double avertissement sonne comme une rupture. Car jusqu’ici, la petite musique dominante affirmait que « l’IA n’est pas une bulle » : sa nature exponentielle justifierait des investissements colossaux et des valorisations vertigineuses.
II. Les leçons de l'histoire : Bernstein et l'illusion des foules
Dans son ouvrage devenu référence, The Delusions of Crowds, l’investisseur et historien William J. Bernstein rappelle que les grandes bulles ne sont pas le fait de l’ignorance mais souvent de l’intelligence enivrée.
De la tulipomanie du XVIIe siècle au krach Internet des années 2000, en passant par les subprimes, une mécanique immuable se dessine :
1. Un récit séduit et fait oublier la prudence.
2. Les anticipations se déconnectent des réalités économiques.
3. L’exubérance se transforme en emballement collectif.
4. La correction, brutale, ramène tout le monde sur terre.
Les bulles apparaissent toujours « évidentes » après coup, jamais pendant. C’est précisément ce que rappelle Bernstein : l’intelligence individuelle ne protège pas contre l’illusion collective.
III. Pourquoi l'IA réunit tous les ingrédients d'une bulle
Les mécanismes caractéristiques des bulles sont déjà visibles dans l’écosystème de l’intelligence artificielle :
• Anticipations extrêmes : les valorisations reposent davantage sur des promesses futures que sur des résultats tangibles.
• Effet mimétique (FOMO) : aucun acteur ne veut manquer la « révolution », tous investissent, parfois à perte.
• Concentration des gains : une poignée de géants captent l’essentiel de la valeur (Nvidia, Microsoft, OpenAI).
• Annonces vertigineuses : des engagements de centaines de milliards de dollars, parfois communiqués avec une légèreté qui interroge.
Un article académique récent (Anchoring AI Capabilities in Market Valuations, 2025) montre combien les valorisations des entreprises « AI-native » sont « ancrées » sur un potentiel encore théorique, bien plus que sur une monétisation effective. Ce décalage — ce que les chercheurs appellent le Capability Realization Rate (CRR) — est un marqueur classique de bulle spéculative.
IV. Mais une bulle peut être... productive
L’originalité de l’IA réside peut-être dans ce paradoxe : si bulle il y a, elle pourrait être productive.
Jeff Bezos l’a formulé clairement : les excès actuels laisseront derrière eux des acquis structurels, infrastructures technologiques (puces, data centers, logiciels), écosystèmes de compétences, intégrations sectorielles, qui survivront au-delà de la correction.
Autrement dit : oui, une partie du capital sera perdue, mais il aura financé des fondations dont la valeur excède la survie immédiate des acteurs. C’est en ce sens que la bulle IA ne serait pas qu’une illusion, mais aussi une phase d’accumulation.
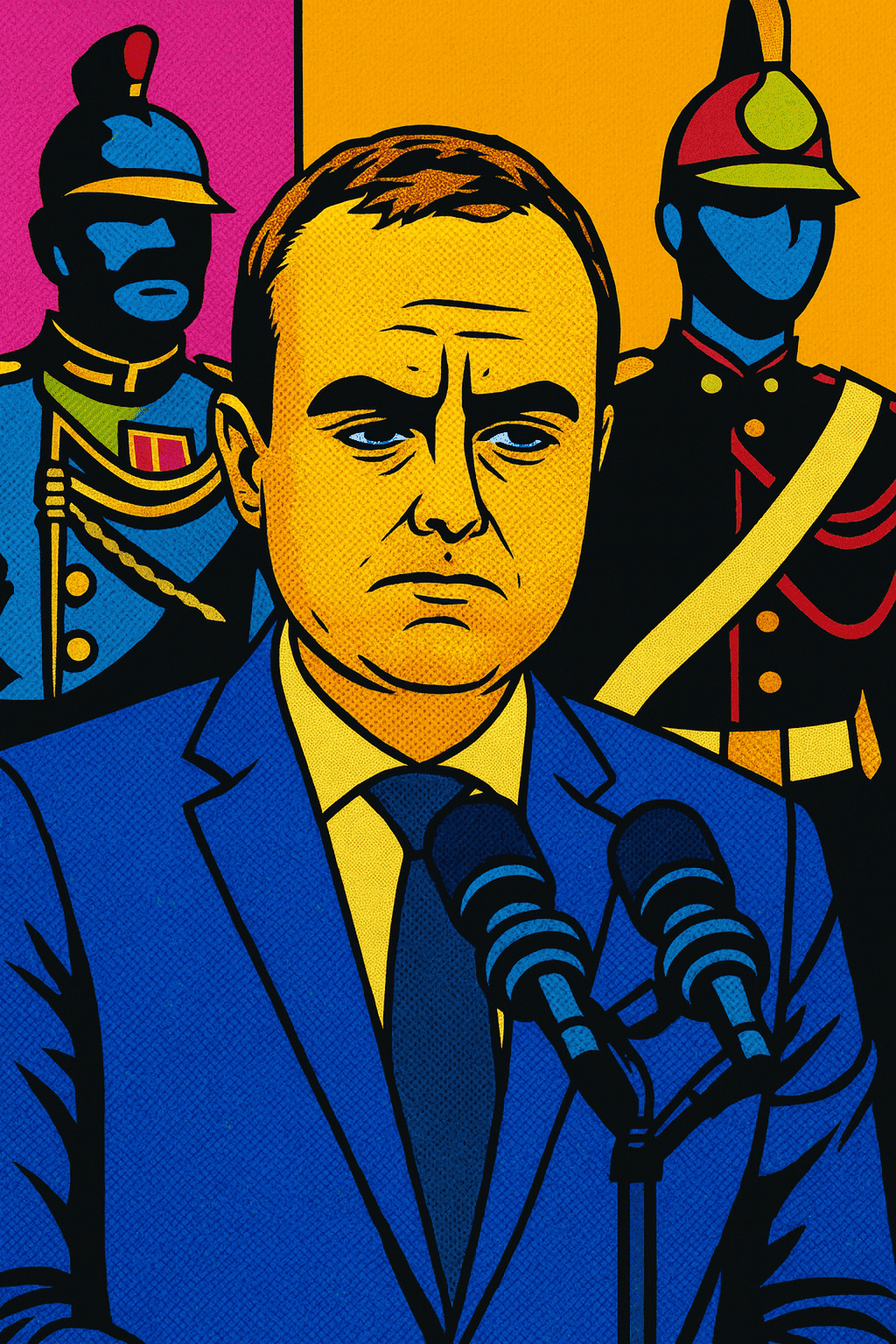
V. Les scénarios prospectifs (2025-2030)
L’avenir de l’IA peut se décliner selon quatre trajectoires plausibles :
1. Éclatement contrôlé (soft landing)
• Les valorisations excessives sont corrigées, mais les acteurs solides survivent.
• Résultat : une consolidation saine du secteur.
2. Krach généralisé (hard crash)
• Un choc de liquidité ou de confiance entraîne une chute brutale (–30 à –60 %).
• Nombreuses faillites de startups, secousses sur les marchés publics.
3. Bulle productive (happy crash)
• Beaucoup d’acteurs disparaissent, mais l’infrastructure et les savoir-faire demeurent.
• L’innovation se poursuit sur des bases assainies.
4. Expansion prolongée (no crash)
• La croissance réelle de l’IA valide les anticipations et retarde la correction.
• Mais la fragilité persiste, avec un risque latent.
VI. Quelle posture adopter face à l'incertitude
Pour les investisseurs comme pour les décideurs, la question n’est pas seulement « bulle ou pas bulle ? ». Elle est surtout : « Comment traverser la correction, si elle survient ? »
Quelques principes de vigilance :
• Exiger des preuves : traction clients, revenus, marges, et pas seulement des promesses.
• Diversifier l’exposition : infrastructures, applications sectorielles, intégrateurs.
• Prévoir des amortisseurs : clauses de sortie, mécanismes de couverture.
• Observer les signaux d’alerte : écart entre valorisations et revenus, dépendance excessive au capital externe, resserrement du crédit.
• Privilégier la résilience européenne : dans un contexte où l’accès au capital est plus limité, la discipline et la robustesse doivent primer sur l’imitation des cycles américains.
Vigilance et lucidité
L’intelligence artificielle est une révolution majeure, comparable à l’électricité ou à l’internet. Mais son potentiel colossal n’immunise pas contre les lois éternelles des marchés : euphorie, emballement, correction.
Le risque n’est pas de voir naître une bulle : il est quasi certain qu’elle existe déjà, au moins en partie. Le véritable enjeu est de survivre à la correction et d’en ressortir renforcé.
L’histoire nous enseigne que les bulles font mal, mais qu’elles fertilisent aussi l’avenir. L’IA n’y échappera pas.









